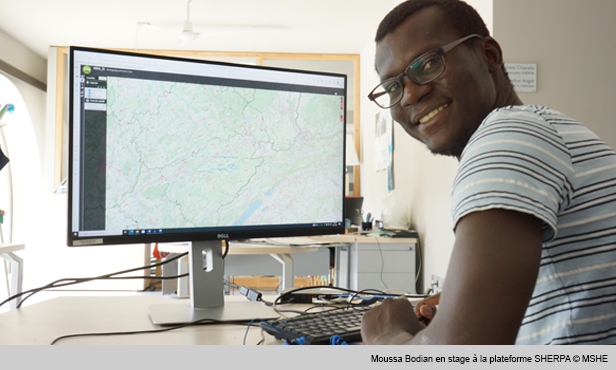 I à nèdji tut lè nœ. Cette phrase qui signifie « il a neigé toute la nuit » est du franc-comtois, l’une des deux langues régionales de la Franche-Comté avec le franco-provençal. Bien que les locuteurs soient peu nombreux au regard de la population régionale, cette langue demeure bien implantée dans certaines localités, au sens où des personnes sont capables de la parler, construire un récit, raconter en franc-comtois. Marion Bendinelli, maîtresse de conférences en sciences du langage et responsable de l’action « Les parlers franc-comtois (PFC) » (1) à la MSHE, évoque deux types de locuteurs : ceux qui en font l’apprentissage aujourd’hui, souvent dans une volonté de revenir vers cette langue que parlaient leurs aïeux, et ceux qui, plongés dans le bain linguistique au sein de la famille ou du village, l’ont intégrée de manière passive. C’est auprès de ces derniers locuteurs qu’ont été menées des enquêtes dialectologiques (2) dans le cadre de l’action PFC. « On va à la rencontre des locuteurs – explique Marion Bendinelli – pour relever et recenser leurs connaissances et leur prononciation de la langue. »
I à nèdji tut lè nœ. Cette phrase qui signifie « il a neigé toute la nuit » est du franc-comtois, l’une des deux langues régionales de la Franche-Comté avec le franco-provençal. Bien que les locuteurs soient peu nombreux au regard de la population régionale, cette langue demeure bien implantée dans certaines localités, au sens où des personnes sont capables de la parler, construire un récit, raconter en franc-comtois. Marion Bendinelli, maîtresse de conférences en sciences du langage et responsable de l’action « Les parlers franc-comtois (PFC) » (1) à la MSHE, évoque deux types de locuteurs : ceux qui en font l’apprentissage aujourd’hui, souvent dans une volonté de revenir vers cette langue que parlaient leurs aïeux, et ceux qui, plongés dans le bain linguistique au sein de la famille ou du village, l’ont intégrée de manière passive. C’est auprès de ces derniers locuteurs qu’ont été menées des enquêtes dialectologiques (2) dans le cadre de l’action PFC. « On va à la rencontre des locuteurs – explique Marion Bendinelli – pour relever et recenser leurs connaissances et leur prononciation de la langue. » Ces relevés détaillés ont vocation à mettre à jour ceux effectués par la linguiste Colette Dondaine dans son Atlas linguistique et ethnographique de la Franche-Comté, paru en quatre volumes entre 1972 et 1991 aux éditions du CNRS. Mettre à jour mais aussi observer les évolutions éventuelles du parler en 30 ou 50 ans, à l’aide d’une carte numérique consultable en ligne. « Nous avons un objectif de valorisation de la langue et de patrimonialisation des données recueillies – poursuit la chercheuse – mais aussi un objectif méthodologique : les atlas sont nés pour recenser, répertorier et montrer comment un parler se réalise sur un territoire. On souhaite actualiser cela avec les technologies d’aujourd’hui. Une carte numérique peut être plus précise et plus riche, parce qu’on peut ajouter des couches de données, et ainsi donner à entendre la langue, comparer des périodes, connaître le locuteur… » Moussa Bodian, actuellement en stage à la MSHE dans le cadre de son master en sciences du langage (3), a pour mission d’élaborer un prototype de carte, avec l’appui de la plateforme technologique SHERPA. Il explique : « En cliquant sur les localités où vivent les locuteurs qui ont été interrogés pour l’action PFC, on visualisera les noms communs qu’ils utilisent, avec leur prononciation telle que nous l’avons relevée dans nos enquêtes et telle qu’elle a été relevée par Colette Dondaine. Ensuite, on voudrait ajouter des extraits sonores et quelques données biographiques du locuteur, comme son âge, son sexe, s’il a toujours vécu ici… ».
Dans une première étape, Moussa Bodian a transcrit intégralement cinq entretiens menés en 2019 dans le Haut-Doubs par Élodie Piranda, alors en 2e année de master (4). Il a réalisé deux formes de transcription : une première orthographique, en s’appuyant sur les normes usuelles du français et une seconde phonétique, en suivant le plus possible les conventions de Colette Dondaine. Car dans son Atlas linguistique, la chercheuse n’a pas eu recours à l’alphabet phonétique international (API) généralement utilisé par les chercheurs mais a adopté une convention que l’on peut situer à mi-chemin entre une transcription orthographique et une transcription phonétique. « Utiliser les normes de Colette Dondaine est surtout utile pour comparer le parler des années 70/90 et d’aujourd’hui, comme on veut le faire avec la carte – précise Moussa Bodian. Et je vais compléter par une transcription en API ». En outre pour étoffer le corpus, il a également programmé de nouveaux entretiens.
A partir de ces transcriptions, Moussa Bodian doit constituer une base de données recensant tous les éléments nécessaires à la carte. Cette dernière sera ensuite réalisée sous le logiciel Lizmap, avec l’aide de Yuji Kato, ingénieur en géomatique à la MSHE. Mais l’équipe n’en est pas encore là. « Ce prototype – reprend Marion Bendinelli – nous permet de réfléchir aux aspects méthodologiques d’une carte numérique, comment réaliser une carte qui offre trois niveaux de lecture de la langue : géographique, linguistique et social à travers les caractéristiques des locuteurs ? Cela pose des questions techniques, de droit et d’accès ou de diffusion, sur lesquelles nous travaillons. » Une fois mis au point le prototype sera mis en ligne, notamment dans la perspective de susciter d’autres recherches. « Des cartes en ligne permettent de rendre accessibles les données linguistiques à un public plus large que les atlas des années 70, qui sont des trésors et de petits bijoux, mais qui restent largement méconnus ! » conclut Marion Bendinelli. Pour favoriser de futurs travaux, Moussa Bodian a également bâti une bibliothèque sous zotero, référençant des ressources scientifiques (publication, thèse, mémoire...) et grand public (ouvrage, reportage TV…) sur les langues régionales (168 références), dont 64 sur le franc-comtois.
Bibliothèque et carte seront mis en ligne en même temps à la fin du stage de Moussa Bodian – un stage qui lui permet d’éprouver une méthodologie qu’il souhaite investir, après son master, dans un projet personnel de valorisation des langues locales au Sénégal.
(1) « PFC - Les parlers franc-comtois : objets du patrimoine, activités de patrimonialisation » dans le pôle 4 « Archive, bases, corpus » de la MSHE.
(2) L’action PFC se déploie en deux axes de recherche : l’un consacré à l’étude des parlers régionaux et l’autre à la place qu’ils occupent dans la société franc-comtoise d’aujourd’hui.
(3 Moussa Bodian est en 2e année de master « analyse du discours » à l’université de Franche-Comté. Il a commencé son stage en février 2022 pour une durée de huit semaines.
(4) L’étudiante ayant travaillé sur certaines formes linguistiques dans son mémoire, ses entretiens n’avaient pas été entièrement retranscrits.
